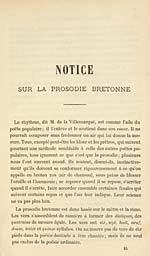Download files
Complete book:
Individual page:
Thumbnail gallery: Grid view | List view
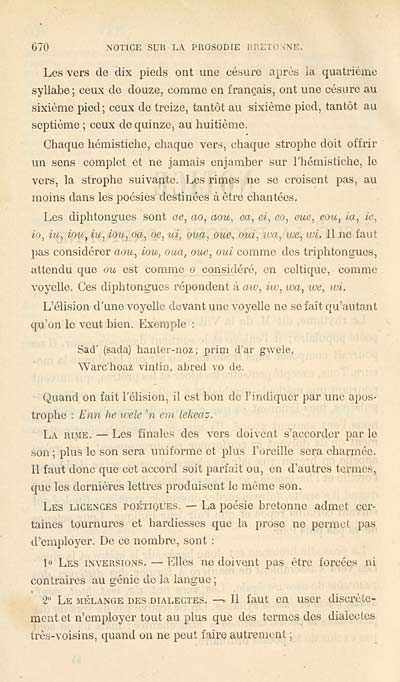
670 NOTICE SUR LA PROSODIE BRETO nNE.
Les vers de dix pieds ont une césure après ia quatrième
syllabe ; ceux de douze, comme en français, ont une césure au
sixième pied; ceux de treize, tantôt au sixième pied, tantôt au
septième ; ceux de quinze, au huitième.
Chaque hémistiche, chaque vers, chaque strophe doit offrir
un sens complet et ne jamais enjamber sur l'hémistiche, le
vers, la strophe suivante. Les rimes ne se croisent pas, au
moins dans les poésies destinées à être chantées.
Les diphtongues sont ae, ao, aou, m, ei, eo, &ue, eou, ia, ie,
io, m, iou^ iu, iou, oa, oe, ui, oua, oue^ oui, wa, we, wi. Il ne faut
pas considérer aou, iou, oua, oue, oui comme des triphtongucs,
attendu que ou est comme o considéré, en celtique, comme
voyelle. Ces diphtongues répondent à aw, iw, tua, we, wi.
L'éhsion d'une voyelle devant une voyelle ne se fait qu'autant
qu'on le veut bien. Exemple :
Sad' (sada) hanler-noz; prim dar gwele,
Warc'hoaz vintin, abred vo de.
Quand on fait l'élision, il est bon de l'indiquer par une apos-
trophe : Enn lie wele 'n eni lekeaz.
La rime. — Les finales des vers doivent s'accorder par le
son ; plus le son sera uniforme et plus l'oreille sera charmée.
Il faut donc que cet accord soit parfait ou, en d'autres termes,
que les dernières lettres produisent le même son.
Les licences poétiques. — La poésie bretonne admet cer-
taines tournures et hardiesses que la prose ne permet pas
d'employer. De ce nombre, sont :
1° Les inversions. — Elles ne doivent pas être forcées ni
contraires au génie de la langue ;
2" Le mélange des dialectes. -^ Il faut en user discrète-
ment et n'employer tout au plus que des termes des dialectes
très-voisins, quand on ne peut faire autrement ;
Les vers de dix pieds ont une césure après ia quatrième
syllabe ; ceux de douze, comme en français, ont une césure au
sixième pied; ceux de treize, tantôt au sixième pied, tantôt au
septième ; ceux de quinze, au huitième.
Chaque hémistiche, chaque vers, chaque strophe doit offrir
un sens complet et ne jamais enjamber sur l'hémistiche, le
vers, la strophe suivante. Les rimes ne se croisent pas, au
moins dans les poésies destinées à être chantées.
Les diphtongues sont ae, ao, aou, m, ei, eo, &ue, eou, ia, ie,
io, m, iou^ iu, iou, oa, oe, ui, oua, oue^ oui, wa, we, wi. Il ne faut
pas considérer aou, iou, oua, oue, oui comme des triphtongucs,
attendu que ou est comme o considéré, en celtique, comme
voyelle. Ces diphtongues répondent à aw, iw, tua, we, wi.
L'éhsion d'une voyelle devant une voyelle ne se fait qu'autant
qu'on le veut bien. Exemple :
Sad' (sada) hanler-noz; prim dar gwele,
Warc'hoaz vintin, abred vo de.
Quand on fait l'élision, il est bon de l'indiquer par une apos-
trophe : Enn lie wele 'n eni lekeaz.
La rime. — Les finales des vers doivent s'accorder par le
son ; plus le son sera uniforme et plus l'oreille sera charmée.
Il faut donc que cet accord soit parfait ou, en d'autres termes,
que les dernières lettres produisent le même son.
Les licences poétiques. — La poésie bretonne admet cer-
taines tournures et hardiesses que la prose ne permet pas
d'employer. De ce nombre, sont :
1° Les inversions. — Elles ne doivent pas être forcées ni
contraires au génie de la langue ;
2" Le mélange des dialectes. -^ Il faut en user discrète-
ment et n'employer tout au plus que des termes des dialectes
très-voisins, quand on ne peut faire autrement ;
Set display mode to: Large image | Transcription
Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. ![]()
| Early Gaelic Book Collections > Blair Collection > Nouveau dictionnaire pratique breton-français du dialecte de Léon > (700) |
|---|
| Permanent URL | https://digital.nls.uk/80901737 |
|---|
| Description | A selection of books from a collection of more than 500 titles, mostly on religious and literary topics. Also includes some material dealing with other Celtic languages and societies. Collection created towards the end of the 19th century by Lady Evelyn Stewart Murray. |
|---|
| Description | Selected items from five 'Special and Named Printed Collections'. Includes books in Gaelic and other Celtic languages, works about the Gaels, their languages, literature, culture and history. |
|---|